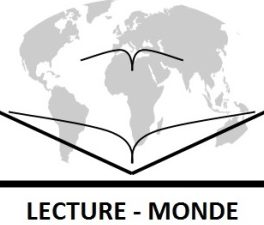Voici la partie finale de l’entretien de Marie-Claude San Juan avec l’universitaire et traductrice Sana Darghmouni sur le sujet de la traduction.
Pour lire les deux premiers épisodes, cliquez ici: Première partie, Deuxième partie
.11. Le philosophe espagnol José Ortega Y Gasset a écrit sur la traduction. (« Misère et splendeur de la traduction » / « Miseria y esplendor de la traducción », 1937, La Nación, journal argentin, puis 2013, éd. bilingue, Les Belles Lettres). Il parle d’un défi, l’impossibilité de rendre compte des transgressions des textes (vocabulaire, grammaire). Mais défi qu’il faut tenir, multiplier (plusieurs traducteurs créent plusieurs lectures et l’ensemble restitue l’essentiel). Sa conception de l’écriture et de la traduction est aussi celle d’une sorte de subversion de la réalité sociale. Connaissez-vous cette pensée ? Rejoignez-vous cette vision ?
Non je ne connais pas cette pensée, mais certainement les traducteurs doivent assurer la médiation entre les cultures, et cela inclut les idéologies, les systèmes moraux et les structures sociopolitiques, ayant comme but celui de surmonter les difficultés qui surgissent le long du chemin qui mène au transfert de sens. Un signe qui a une valeur dans une communauté culturelle peut être dépourvu de sens dans une autre, et le traducteur se trouve inévitablement obligé d’identifier cette disparité et d’essayer de la résoudre. Cela peut également impliquer la subversion de la réalité sociale. C’est intéressant !
.12. Avez-vous lu « Partages », d’André Markowicz (éd. Inculte, 2018), traducteur d’auteurs russes en français ? Il y a réuni des chroniques parues sur Facebook, dans le but, cette écriture sur Facebook, de sortir de la solitude du travail devant les pages, en rendant compte des étapes, recherches, comme un journal de jour en jour. Le titre dit son éthique, et sa définition de la traduction, comme partage principalement. Est-ce le mot que vous reprendriez pour définir ce qu’est traduire ?
La traduction n’est pas évaluée en fonction de sa fidélité ou de sa distance par rapport à l’original, mais en fonction de sa fidélité à la culture et à la langue auxquelles elle s’adresse. La traduction est un outil pour créer une culture et agrandir une langue, en y introduisant des échos d’autres langues. Donc si la traduction reflète cela, elle peut être définie partage.
.13. André Markowicz a réalisé quelque chose d’extraordinaire, en publiant des poèmes chinois de la poésie Tang, sans connaître le chinois. « Ombres de Chine », éd. Inculte, 2015). En faisant la transcription des textes à partir de la lecture de nombreuses traductions (c’est réussi et reconnu comme tel). Il rejoint ainsi l’idée de José Ortega Y Gasset, indirectement, celle de la restitution par des traductions plurielles. Mais c’est aussi l’idée particulière qu’un lecteur peut entrer dans l’univers d’une langue à travers une démarche comparative, en allant d’une transcription à une autre. Cela ouvre bien des perspectives. On se dit que tout peut être inventé dans le domaine de la traduction. La lecture des autres traducteurs est-elle un outil de maîtrise de cette pratique, y compris quand ils traduisent les mêmes langues et les mêmes auteurs que soi ? Ou faut-il s’en éloigner, à votre avis, pour ne pas risquer d’être influencé et de perdre sa voix propre, sa méthode singulière ?
Tous les deux. Il faut lire les autres traducteurs pour maîtriser la pratique de la traduction, entrer dans son univers et confronter les autres. Ce sont les traductions des différentes relations de l’homme avec le monde, que chaque traducteur exprime à sa manière. Ensuite, nous devons également nous éloigner des traductions des autres pour ne pas être influencé et pour ne pas perdre notre propre voix. J’aimerais bien lire comment un autre traducteur traduirait un texte que j’ai traduit. Ce serait une belle comparaison.
.14. Traduire, serait-ce une nécessaire mais fausse résistance à la domination d’une langue mondiale (l’anglais actuellement, d’autres langues avant), comme le pensait Pascale Casanova (« La langue mondiale, traduction et domination », éd. Seuil, 2015) ? Elle insistait sur la conscience qu’il faut avoir de ces rapports de pouvoir, des hiérarchies entre les langues (tout en sachant utile la langue mondiale qui permet la communication à l’échelle planétaire, mais qui est plus traduite qu’elle ne produit de traductions). La solution serait-elle alors de traduire de plus en plus les langues non dominantes, pour redonner le sens de leur valeur à leurs locuteurs et finalement aux locuteurs de la langue universelle de l’époque ?
Oui, une solution pourrait être de traduire de plus en plus les langues non dominantes et d’accéder à leurs lecteurs. Le monopole linguistique nuit au but même de l’écriture et de la créativité. Pourquoi priver le lecteur de connaître la beauté d’un texte uniquement parce qu’il est écrit dans une langue parlée par peu et non dominante? Ici, je crois qu’on pourrait ouvrir des discours sur l’édition et les choix des éditeurs qui visent à gagner et vendre. Mais heureusement, il y a maintenant une publication en ligne et pas seulement une publication en papier et cela aide à publier sans frais et sans les politiques des éditeurs.
.15. L’Américaine Emily Apter, consciente de la domination de l’anglais, interroge le rapport aux langues et à la traduction dans le cadre des conflits et des effets de « l’altérité intraduisible ». Son livre, « The Translation Zone. A New Comparative Littérature » a été traduit en français, « Zones de traduction. Pour une nouvelle littérature comparée », éd. Fayard, 2015. Elle voit dans le plurilinguisme une réponse, s’intéresse à la pensée d’Edward Saïd, à l’idée de littérature-monde. On retrouve aussi chez elle une conception particulière de la traduction comme création, jusqu’aux « pseudos-traductions », inventions d’œuvres attribuées à des auteurs fictifs, mais vraies créations littéraires. Mais elle met la traduction effective à la même hauteur créative.
Traduire l’intraduisible, comme elle le pose en défi, est-ce l’enjeu de la traduction contemporaine, consciente de ces zones de langage qui traversent les frontières apparentes, et les effets de l’histoire (conflits, colonisations, migrations) ? Et la traduction est-elle, aussi, en train de changer de statut créatif ?
La traduction et les problèmes qu’elle pose – tant sur le plan linguistique que sur celui, plus large et plus spécifique, de la philosophie de la parole – sont au centre de la réflexion desécrits de Paul Ricoeur. Le philosophe essaie de résoudre le dilemme éthique et théorique perpétuel posé par tout exercice d’intercommunication culturelle entre différentes langues parlées et écrites. La loyauté et la trahison, le problème éthique; construction de la comparabilité en l’absence d’une langue commune et originale, le problème théorique.
Le traducteur peut cependant recourir à différentes stratégies de traduction afin de combler le vide lexical. Par conséquent l’intraduisibilité ne crée pas de problèmes excessifs en termes de « relativité linguistique » puisque le sens d’un texte ou d’un mot peut toujours être traduit également, sinon d’une manière parfaite d’un point de vue technique.
.16.Enfin, retour au site-revue de littérature du monde, «La macchina sognante ». Pouvez-vous en retracer l’histoire, et les liens qu’il peut avoir avec les questions précédentes et avec votre démarche personnelle ?
Comme je l’ai déjà dit, LMS est un projet né d’un groupe de personnes qui partagent un amour de la littérature. Nous avons atteint le numéro 19 maintenant. Un numéro sort tous les 4 mois et contient entre 40 et 45 articles sur la poésie, la critique, le théâtre… Beaucoup de travail est dû à la traduction, bien sûr, puisque nous parlons de littérature mondiale.
***
Sana DARGHMOUNI: Traductrice et universitaire. Elle collabore à la revue La machina Sognante . Elle est auteure d’essais.
Propos recueillis par Marie-Claude SAN JUAN: poétesse et blogueuse. Elle collabore à plusieurs revues. Livre: (photographies et textes) Ombres géométriques frôlées par le vent, éd. Unicité, 2020.