Après Millenium Blues, Faïza Guène publie son roman, La discrétion.
La famille Taleb vit depuis des décennies à Aubervilliers, ville dans la banlieue parisienne ; hormis une fille qui vit seule, tous les membres partagent le même appartement. Tous les enfants, un homme et trois filles, sont nés en France ; les parents viennent d’Algérie.
Le père Brahim est un ancien ouvrier des mines et des chantiers. Yamina, la mère, est née pendant la colonisation dans un douar algérien, et a grandi dans la misère et la violence avant de venir en France. «(…) mais derrière Yamina, il y a une Histoire » (p25). Histoire en majuscule.
Dans une France où subsistent la haine, l’injustice, la xénophobie, le problème identitaire…la maman choisit la discrétion qui est synonyme d’auto-effacement. « C’est comme ça benti, on doit accepter, on est comme leurs invités, on est chez eux » (p135), dit Yamina à une de ses filles, la conseillant d’être discrète. Même si elle est en France, elle lègue à ses enfants son passé, son histoire en fragments, et le poids de la tradition…
Suspendus dans un entre-deux complexe (France-Algérie ; leur présent et le passé des parents), les enfants se trouvent désorientés, jugeant que « qui est on est » est devenu très compliqué. Contrairement à la mère, ils sont en colère car ils ont la violence enfouie en eux. Alors d’où vient-elle cette violence ? Choisiront-ils la discrétion pour ne pas décevoir les parents, ou bien crieront-ils leur colère pour réparer l’offense faite aux géniteurs? Yamina choisit-elle l’intégration quand son retour est devenu impossible?
L’auteure explore la relation entre les parents immigrés et leurs enfants nés sur le sol français ; le roman s’intéresse à la violence que portent en eux les enfants. Ils sont en colère. Contrairement à eux, la maman Yamina choisit la discrétion pour mener une existence silencieuse et tranquille. Être discret c’est choisir l’effacement. S’effacer soi-même. Par exemple, la maman dit « s’il te plait, reste discrète » (p201) à sa fille Malika qui a parlé en arabe à un chibani à la mairie où elle travaille.
Pour les enfants, étouffer la colère c’est choisir la faiblesse. Avec cette colère, ils luttent contre l’effacement et tentent de venger les sacrifies des parents exilés, ayant tout laissé derrière eux au bled.
La société française, caractérisée par la haine et les injustices, alimentent leur colère. « Fabienne en a marre de ce défilé de races, de dialectes, de figures amochées et d’histoires intimes qu’elle n’a pas envie d’entendre » (p21), dit la Française Fabienne. Pour les enfants Taleb, cette France-là se divise en deux : Eux et Nous. Les premiers sont les « Français de souche » et les autres sont les enfants des immigrés. Entre les deux, il n’y a pas de cohabitation, mais un duel.
D’où vient cette violence ? Avec divers mécanismes et scènes, le roman précise que les enfants ont hérité, malgré eux, cette violence des parents exilés ; notamment de la maman. Le père est moins évoqué dans le roman, presque absent. Yamina est née pendant la colonisation en 1949 ; elle a ensuite vécu le premier exil au Maroc (Ahfir) ; elle a été arrêtée de l’école pour éduquer ses frères et sœurs ; elle travaillait avec son père dans la ferme et aidait financièrement la famille avec sa machine à coudre….
Trop de violence subie dès le bas âge ! Une femme sans enfance ! « Cette colère, ses parents se sont pourtant évertués à l’étouffer en eux. Ils se sont donné tellement de mal pour la dissimuler, pour en protéger Hannah, ses sœurs et son frère » (p 196.). Bref, même si les immigrés étouffent la violence en eux, ils l’inoculent à leurs enfants. Transmission intergénérationnelle.
Parler d’enfants d’immigrés c’est parler d’entre-deux. Pas un entre-deux géographique mais identitaire, existentiel. « C’est ainsi qu’ils avaient inventé instinctivement leurs lois hybrides, à mi-chemin entre le village de leur souvenir et leur idée d’ici » (p58). Les enfants Taleb sont suspendus entre le souvenir d’une Algérie où ils vont (sans joie) pour des vacances, et une France où ils se sentent perdus. Suspendus aussi entre leur génération (ils sont tous trentenaires), et celle des parents.
Suspendus en plus entre leurs rêves et la tradition des parents. Malika a accepté un mariage arrangé pour ne pas décevoir les parents ; Yamina gâte trop Omar car dans la tradition algérienne un garçon est préféré à une fille ; quand Imane a parlé de son projet d’appartement de célibataire, sa mère a répondu : « Tu veux tuer ton père ? »(p59). Donc malgré eux, ces immigrés ont fait de leurs enfants, des êtres accablés, égarés, en colère.
L’auteure rend hommage aussi à la femme. Contrairement au père qui est peu évoqué, la maman Yamina est omniprésente. La famille Taleb a un fils et trois filles. Çà et là, le narrateur omniscient fustige la misogynie et ses facteurs comme la tradition. Par exemple, il fustige les films westerns où le cow-boy touche une femme sans son consentement, donc la viole. Il fustige aussi l’exploitation de l’espace public en Algérie par les mâles… Si les hommes meurent une seule fois, « Les femmes, elles, sont tuées par leur propre monde, et ce, des milliers de fois. Elles ne cessent de ressusciter, matin après matin » (p54). Ce roman est aussi un cri féministe.
L’Histoire est présente. Le père de Yamina est un moudjahid. Le roman présente aussi des fragments historiques comme la guerre d’Algérie et l’Indépendance (1962). L’auteure rend un vibrant hommage aussi à Djamila Bouhired, évoquée dans la fiction, et citée dans la dédicace. « (…) Djamila Bouhired n’était pas seulement un symbole du combat pour la liberté en Algérie, Djamila Bouhired était l’Algérie » (p89.).
Le roman est hybride et trouve sa cohérence et sa richesse dans la diversité. Les espaces français se mêlent aux espaces maghrébins comme Tlemcen, Témouchent, et Ahfir (Maroc). Les noms français côtoient les noms d’origine maghrébine. Le français littéraire cohabite avec le français des banlieues et les mots emprunts au dialecte algérien. Les religions et les cultures se croisent et se séparent (une des filles Taleb sortait avec un Asiatique).
L’ethnographie et la sociologie sont présentes. Le narrateur décrit des traditions, des modes de vies…dans les deux rives comme le tatouage algérien, les comportements et la langue des Français en banlieue ; des faits réels insérés dans la fiction. « D’habitude, arrivés à un certain degré de réussite sociale, les garçons arabes se pavanent au bras d’une femme blanche comme preuve ultime et irréfutable de leur succès » (p71).
La gestion du temps est attirante. Il s’agit d’une alternance de deux parties, l’une se déroule en Algérie (un épisode a lieu au Maroc) à partir de 1949, l’autre se déroulant en France à partir de 2018. Les deux parties se fusionnent à la fin en France en 2020. C’est un signe d’intégration ? Le passé est très souvent raconté au présent : cette actualisation attire l’attention du lecteur.
La langue est simple et embellie par l’humour, l’ironie, et les jeux de mots. Cette légèreté de la langue permet ainsi de dire les choses les plus compliquées. « …il avait des airs de Jacques Brel qui aurait trempé longtemps dans l’huile d’olive » (52).Cela rappelle les romans d’Azouz Begag où la gravité est narguée par l’humour.
L’auteure a inséré discrètement des éléments autobiographiques dans la fiction. Comme les enfants Taleb, elle est née de parents algériens dans une ville de la banlieue parisienne (Bobigny) ; et comme eux, elle a dépassé les 30 ans (née en 1985) ; comme Brahim Taleb, son père est née dans les années 1930 et a travaillé comme mineur et ouvrier des bâtiments ; comme Yamina, sa mère est arrivée en France dans les années 1980…Bref, le roman est une autobiographie ou une autofiction (autobiographie romancée) ?
Pour une lecture croisée, il est important de lire Azouz Begag, Akli Tadjer, Dalie Farah, Nina Bouraoui… dont les écritures ont beaucoup de points communs avec celle de Faïza Guène : l’entre-deux, l’identité entre deux rives, la relation entre immigrés et leurs enfants, etc.
Simple et profond, imprégné d’humour et de réflexions, La discrétion est un hommage aux immigrés qui lèguent malgré eux la violence à leurs enfants. C’est aussi un pont entre les générations, entre l’Algérie et la France, entre le passé et le présent.
***
Point fort du livre : la gestion des temps.
Belle citation : « Comment ne pas craindre l’effacement ? C’est ce que ce pays savait faire de mieux, il avait déjà tenté de les effacer, eux (les parents), et maintenant il s’en prenait à leurs gosses » (p58).
L’auteure: née en 1985en France de parents algériens, Faïza Guène est romancière et scénariste. Son premier roman Kiffe kiffe demain a eu un succès mondial. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues.
La discrétion, Faïza Guène, éd. PLON, France, 2020, 256p.
Par TAWFIQ BELFADEL
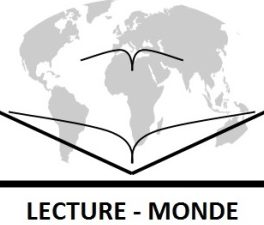

Un avis sur « La discrétion – de Faïza Guène: les enfants d’immigrés héritent la violence des parents »