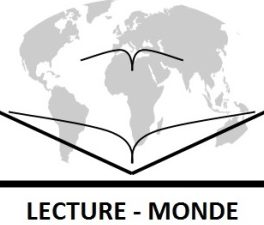Le dernier roman d’Atiq Rahimi, Les porteurs d’eau, publié en grand format en 2019 chez POL, vient de sortir en format poche chez Gallimard (Collection Folio).
Pour lire la critique de son dernier livre (récit) publié en 2020, cliquez ici: L’invité du miroir.
Divisé en 30 chapitres, le roman Les porteurs d’eau raconte deux récits différents l’un de l’autre, mais reliés par un fait commun : la destruction des Bouddhas de Bâmiyân par les Talibans en 2001, en Afghanistan. Le pays était noyé dans une troisième phase de guerre civile.
Le premier récit est celui de Tamim, un Afghan exilé à Paris. Agé de 45 ans, il change de nom suite à sa naturalisation : il devient Tom. Le jour de la destruction des Boudhas, Tom décide de changer de vie et choisit un autre exil : il quitte Paris en laissant sa femme et son enfant, pour s’installer définitivement avec son amante à Amsterdam, une ville où ne viennent « que les hommes perdus afin de se retrouver » (p191).
En route, sa mémoire le taraude de pensées et de questions sans réponses : ses origines, ses parents et ses ancêtres, Kaboul, ses vérités et ses mensonges.
Le deuxième récit est celui d’Yûsef, un porteur d’eau Afghan vivant à Kaboul. Coupé des racines, il vit avec sa belle-sœur Shirine qui a été abandonnée par son mari. Yûsef doit fournir l’eau aux habitants et veiller sur sa belle-sœur. Le jour de la destruction des statues, tout change à Kaboul : le mullah oblige tout le monde à venir à la mosquée pour fêter la chute des Bouddhas. Lors de ses va-et-vient entre la source et la ville, la mémoire le taraude de pensées et de questions sans réponses, tout comme Tom ailleurs : il pense surtout à Shirine qui s’est murée dans le silence.
Alors Tom réussira-t-il à entamer une nouvelle vie, un autre exil à Amsterdam? Et si Yûsef tombait-il amoureux de sa belle-sœur, sous le règne des Talibans ?
Atiq Rahimi ne centre pas sa plume sur un thème unique. Il fusionne plusieurs thèmes les uns avec les autres, tous récurrents dans ses œuvres. Il y a d’abord l’exil qui est peint sous la forme d’un cycle : quand l’exilé s’éloigne de sa terre, elle le rattrape dans un autre tournant. Tom a changé de nom pour tourner le dos à l’Afghanistan, mais découvre tard que son amante d’Amsterdam avec qui il va commencer une nouvelle vie est une Afghane.
Le roman montre que la vie elle-même est un ensemble d’exils : errer en permanence d’une terre à l’autre, se perdre pour se retrouver. Tous les humains sont des exilés. « A quarante-cinq ans, tu es toujours en errance. Un exilé errant, un technico-commercial, un commis voyageur, un amant fugitif, un mari en cavale, un père absent » (p121). Donc l’exil c’est savoir se doubler : être soi-même et un autre, ici et ailleurs.
Il y a aussi la guerre civile qui est récurrente chez Atiq Rahimi. Cette guerre détruit le pays et bouleverse la vie des habitants. Yûsef par exemple, sa belle-sœur, son ami intime, deviennent des autres, étrangers à eux-mêmes.
En outre, il y a le thème du secret. Chaque personnage porte un secret en lui qu’il essaie tout au long de la fiction de découvrir et avouer. Tout comme les personnages, le lecteur est envahi par le suspens et se hâte de découvrir tous ces secrets.
Enfin, il y a le thème de la mémoire. Le temps de l’intrigue est court, l’espace est limité. Secoués par les évènements, les personnages s’isolent et se réfugient dans la mémoire et ses flux profonds : ils pensent jusqu’à faire de certains faits des obsessions. Tom se demande pourquoi son amante lui a caché sa vraie identité. Yûsef se demande pourquoi Shirine cite le nom de son ami Bahari dans ses rêves.
La structure du roman est attirante. Les deux récits s’alternent l’un après l’autre. Le roman fait balancer le lecteur de Tom à Yûsef, de Paris-Amsterdam à Kaboul. La narration passe aussi du narrateur qui tutoie les personnages à un narrateur omniscient. Ce procédé narratologique sert à attirer le lecteur et l’incite à s’investir dans le roman. L’écriture d’Atiq Rahimi est une mosaïque mêlant poésie, sagesse, mythologie, bouddhisme, soufisme, et fragments autobiographiques.
Inspiré par un grand évènement historique (destruction des Bouddhas), Les Porteurs d’eau est une fresque sur l’exil, la terre natale, l’amour interdit, et la sagesse de vivre. Un roman merveilleux par son amertume !
Pour découvrir les autres livres sur le thème de l’identité, cliquez ici: l’identité
***
Point fort du livre: structure narrative.
Belle citation: « La vie est semblable à l’eau, selon un adage que ta mère répétait souvent. Elle coule dans le sens de la pente, et il ne faut pas la détourner, sinon elle t’emportera avec elle ou croupira. »
L’auteur : né en 1962 à Kaboul, Atiq Rahimi est un écrivain et réalisateur. Son roman Syngué sabour a été récompensé par le Goncourt en 2008. Il vit en France.
Les Porteurs d’eau, Atiq Rahimi, éd. P.O.L, France, 2019, 288p.
- Cette critique a été faite à partir de la version des éditions POL.
- Cet article a été publié auparavant par le même rédacteur dans un autre média.
Par TAWFIQ BELFADEL