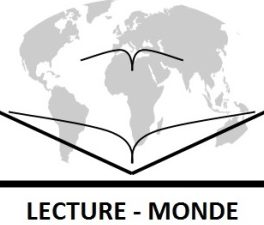Après son premier roman Le ciel sous nos pas (éd. Albin Michel 2019), Leila Bahsaïn publie le deuxième chez le même éditeur : La théorie des aubergines.
Pour lire la critique du précédent roman cliquez ici : Le ciel sous nos pas
Khadidja, dite Dija, travaille dans une agence de communication dans la ville de Plombières. Du jour au lendemain, elle est licenciée parce qu’elle ne s’adapte pas à la digitalisation du domaine et la refuse. « Lundi au chômage. Je suis sortie du cadre, tombée dans un hors-temps » (p13).
Le contexte est celui du capitalisme et matérialisme effrénés : le secteur d’emploi devient une déshumanisation. Le nouveau propriétaire de l’agence propose à Dija une mission : encadrer dans la cuisine de l’agence des gens exclus de l’emploi, pour les aider à la réinsertion sociale. Rapidement, ces gens de différentes cultures deviennent une famille soudée ; en plus des plats appétissants, la Cuisine leur favorise le dialogue sur le vivre-ensemble en paix et ses entraves. C’est une expérience humaine. « Cuisiner n’est pas cuisiner. Cuisiner est une entreprise de psychologie. Un altruisme courtois » (p132)
Le préfet est invité par l’agence à un repas dans la Cuisine. Et si ce grand rendez-vous tournait-il au drame ? La Cuisine réussirait-elle à réparer les exclusions sociales et à promouvoir la cohabitation heureuse ?
Le roman n’est pas une fiction sur l’emploi ou la cuisine ; ces deux éléments constituent seulement l’arrière-plan, un prétexte. À travers la cuisine, le roman interroge la relation à l’Autre et explore le vivre-ensemble en paix en France. Ainsi, le lieu La Cuisine n’est pas un simple espace mais un carrefour où se croisent les multiples sujets sur la cohabitation aujourd’hui : xénophobie, frontières, discrimination, clichés, identité, etc. L’intimité du lieu favorise l’échange interculturel. « Ah, si seulement les gens adoptaient les gens, les différences et les autres cultures comme ils s’emparent des plats venus d’ailleurs » (p118). Autrement dit, cuisiner devient « un acte de l’esprit » (p120).
Le roman fustige ainsi tout ce qui empêche le vivre-ensemble en paix comme les frontières, le mot « étranger », les extrêmes…Née au Maroc, Dija est réduite à trois mots-clichés : arabe-musulmane-étrangère. Autre membre de la Cuisine, Ishtar est exclue de la société à cause de non foulard qui n’est pour elle qu’un effet de look. En d’autres termes, le roman est un cri contre l’effacement et l’exclusion. En revanche, il fait l’éloge de la diversité, de l’humain-puzzle, de l’identité-monde qui réconcilie les êtres avec eux-mêmes. Les différences sont une richesse pour le Moi et l’Autre. Dija vient du Maroc mais ne se sent pas étrangère : son mari est français, ses enfants sont nés en France. Ishtar est née aux USA d’un père syrien et d’une mère tunisienne…« Je jongle avec mon identité multiple qui valse sur un triptyque : Mon Maroc, ma France occidentale et ma France orientale. Je suis les trois et bien plus encore » (p62).
Même les plats cuisinés favorisent la diversité : ils trouvent leurs saveurs uniques dans ces divers éléments proposés par les membres. Par exemple, on parle de briouates (Maroc), de samoussa (Asie), et de bricks (Maghreb et Orient) pour désigner la même chose.
Le roman fustige aussi la déshumanisation qui sévit en société et notamment dans le monde de l’emploi. L’humain est moins cher que l’image de l’entreprise ou la marchandise. L’humanité des êtres est un chiffre. Exemple : Khadidja est surnommée Dija par son ex-employeur pour cacher le coté « arabe » de son nom. « Avant, on se mobilisait pour la guerre. Maintenant, on se mobilise pour les entreprises et les carrières. Alors la guerre ou le travail ! » (p230). Le livre permet ainsi de découvrir les dessous sales de l’emploi occultés derrière les slogans d’insertion et de socialisation. Ainsi, le roman rend hommage à tous ces gens mis à la marge dans la société à cause de leurs différences.
Le livre célèbre en outre la campagne. Le lieu principal est Plombières où la nature l’emporte sur le béton, contrairement à la majorité des romans qui sont ancrés à Paris. Celui-ci est même désacralisé. « Allez voir dans les sous-sols des restaurants de la Ville lumière, là, sous les pieds des touristes, et vous comprendrez le goulag. » (p 231) dit un personnage.
Le roman fait çà et là des va-et-vient entre France et Maroc, pays natal de l’auteure. Tout comme dans le premier roman. La cuisine bâtit ainsi des ponts entre les deux rives .« Cette odeur suffit pour que je reparte vers les territoires de mon enfance(…) Le Maroc me revient par la nourriture. » (p156)
Pour découvrir d’autres livres en relation avec le Maroc, cliquez ici: Lettres du Maroc
Le livre fait l’éloge de l’écriture comme passion littéraire et aussi l’écriture classique celle qui sacralise le rapport au papier. Bien que le monde adopte le digital, la narratrice la refuse et préfère écrire à l’ancienne. Pour elle, l’écriture est un refuge, un cri contre les injustices du monde. « Elle s’emploiera à écrire. A trouver refuge dans les mots. L’écrit, patrie choisie. Les cris.(…)Les mots, une façon de se soustraire au corps. A toutes les prisons qu’on lui assigne à cause du corps » (p139).
La poésie est très présente. Des phrases sont des poèmes insérés dans la prose. Cela embellit le roman et lui donne plus de beauté. « Il me susurre des mots et il devient poète. Et mon bas-ventre se mue en centre. Cœur qui bat entre mes jambes. Des milliers d’ailes. Je redeviens liquide » (p 170).
L’auteure a inséré des pans autobiographiques dans cette fiction sans faire de l’autobiographie : le Maroc (pays natal), La France (pays de résidence actuelle), éloge de l’écriture (elle est écrivaine), le monde de l’emploi et la communication (son domaine de travail)…Ainsi, Leila se dit à travers ses personnages.
Pour une lecture croisée, il est utile de voir le spectacle de l’humoriste Mohammed Fellag Petits chocs des civilisations (2011) qui est une réflexion sur le vivre-ensemble à travers le couscous vu comme « un lien entre les communautés et les sensibilités ». (Spectacle). Tant de points communs existent entre ce monologue et le roman de Leila.
Humain, imbibé de poésie et nourri de réflexions, La théorie des aubergines est un roman qui promeut le vivre-ensemble en paix par la cuisine à l’ère des déchirements identitaires. Un sensible hommage aux gens mis à la marge à cause de leurs différences et un cri contre toute déshumanisation.
***
Point fort du livre : symbolique de la cuisine
Belle citation : « Je ne veux être ni origine ni peau ni sexe. Juste être moi-même. Je suis libre d’être de partout. Ni racine étouffée ni aile brisée. Non, ni racine ni aile, un être de mots et de sang dont le propre est de circuler et de se renouveler »(p 63)
L’auteure : Leïla Bahsaïn est jeune écrivaine franco-marocaine. Elle a travaillé dans la communication. Elle s’occupe de Zitoun, association d’alphabétisation des femmes au Maroc. Ses nouvelles ont été récompensées au Maroc. Elle vit en France.
La théorie des aubergines, Leïla Bahsaïn, éd. Albin Michel, France, 2021, 256 p.
Par TAWFIQ BELFADEL